Les droits de douanes sont-ils illégaux ?
Ce qui pourrait bien être la plus grande bataille à ce jour dans la guerre commerciale de Donald Trump a commencé la semaine dernière.
L'administration Trump s’est présentée mercredi 5 novembre devant la Cour suprême des États-Unis pour affronter des petites entreprises et un groupe d'États qui affirment que la plupart des droits de douane qu'elle a mis en place sont illégaux et devraient être annulés.
La décision finale des juges interviendra après plusieurs mois d'examen approfondi des arguments et de discussions sur le fond de l'affaire. Un vote aura ensuite lieu.
En effet, à la fin du mois de mai 2025, la Court of International Trade (CIT) a estimé que certaines mesures tarifaires, notamment celles introduites en avril sous le nom de “Liberation Day tariffs”, allaient au-delà des prérogatives que confère au président la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale (IEEPA).
L’IEEPA confère au président le pouvoir « de faire face à toute menace inhabituelle et extraordinaire, dont la source se situe en tout ou en partie hors des États-Unis, à la sécurité nationale, à la politique étrangère ou à l’économie des États-Unis, si le président déclare une urgence nationale à l’égard de cette menace ».
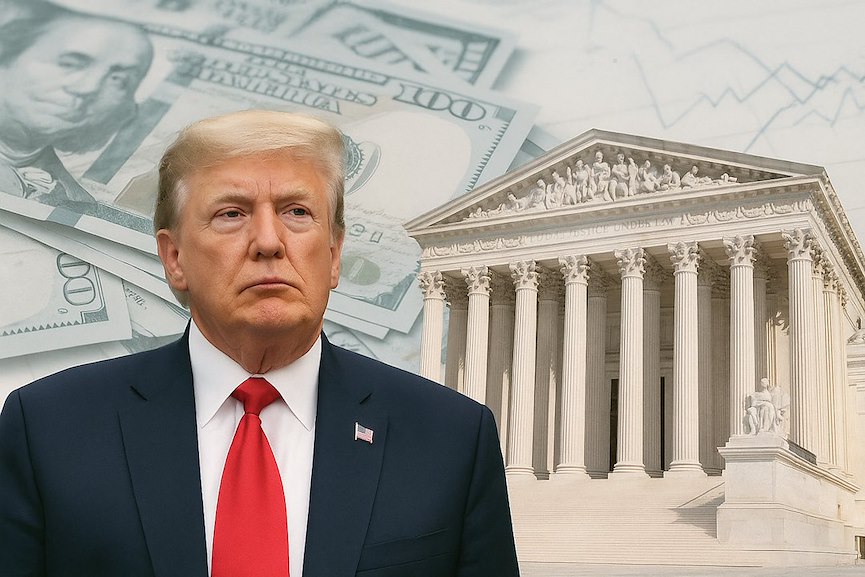
En déclarant l'état d'urgence en vertu de cette loi, Trump peut émettre des décrets immédiats et contourner les procédures établies, plus longues.
Trump a invoqué cette loi pour la première fois en février afin de taxer les marchandises en provenance de Chine, du Mexique et du Canada, affirmant que le trafic de drogue en provenance de ces pays constituait une situation d'urgence.
Il a réitéré ce recours en avril, ordonnant des taxes allant de 10 % à 50 % sur les marchandises provenant de presque tous les pays du monde. Cette fois, il a déclaré que le déficit commercial américain, constituait une « menace extraordinaire et inhabituelle ». Ces droits de douane se sont imposés par à-coups cet été, tandis que les États-Unis incitaient les pays à conclure des « accords ».
Cette décision a marqué la première reconnaissance officielle du caractère ultra vires, c’est-à-dire illégal par excès de pouvoir, de ces nouvelles taxes.
Quelques mois plus tard, en août 2025, la Cour d’appel fédérale a confirmé cette lecture en déclarant que la législation américaine « ne confère pas au président l’autorité d’imposer des droits de douane illimités ». Plusieurs médias américains, dont The Guardian et ABC News, ont rapporté que ces décisions créaient un précédent inédit, restreignant la capacité du président à agir unilatéralement sur la politique commerciale sans l’aval du Congrès.
Toutefois, la Cour suprême des États-Unis n’a pas encore tranché. Les taxes demeurent en vigueur, car les jugements des tribunaux inférieurs ont été suspendus dans l’attente de la décision finale. Les juges suprêmes devront déterminer si Trump a violé la doctrine de non-delegation, selon laquelle le Congrès ne peut déléguer de manière illimitée ses pouvoirs législatifs à l’exécutif.
La guerre commerciale ne devrait pas prendre fin, même si la Cour suprême interdit à Trump d'utiliser l'IEEPA. Il existe d'autres textes de loi sur lesquels il peut s'appuyer. La Section 201 du Trade Act of 1974 permet au président américain d’instaurer des mesures de sauvegarde temporaires lorsqu’une hausse soudaine des importations cause ou menace de causer un préjudice grave à une industrie nationale.
Contrairement aux Sections 301 ou 338, elle ne vise pas à punir un pays étranger pour des pratiques déloyales, mais à protéger temporairement un secteur stratégique le temps qu’il s’adapte à la concurrence. Les mesures peuvent prendre la forme de droits de douane, de quotas ou d’autres restrictions quantitatives.
La procédure débute par une enquête menée par la U.S. International Trade Commission (USITC), souvent à la demande d’une entreprise, d’un syndicat ou du président lui-même. Si la Commission conclut qu’une industrie subit un préjudice sérieux, elle recommande des mesures correctives. Le président dispose alors du pouvoir discrétionnaire de les appliquer, pour une durée maximale de quatre ans, prolongeable jusqu’à huit ans dans les cas jugés exceptionnels.
Historiquement, la Section 201 a été utilisée à plusieurs reprises. En 2002, George W. Bush l’a invoquée pour imposer des tarifs pouvant atteindre 30 % sur l’acier, avant de les lever sous la pression de l’Union européenne et de l’OMC. En 2018, Donald Trump s’en est servi pour taxer les panneaux solaires et les machines à laver importés, marquant ainsi le début de son approche protectionniste avant même la guerre commerciale contre la Chine.
En outre, il y a la Section 122 du Trade Act of 1974 qui confère au président américain le pouvoir d’imposer temporairement des droits de douane afin de corriger un déséquilibre de la balance commerciale ou des comptes extérieurs. Concrètement, elle autorise des tarifs pouvant aller jusqu’à 15 % sur l’ensemble des importations pour une durée maximale de 150 jours, sans approbation préalable du Congrès.
Le président doit toutefois notifier le Congrès et consulter le FMI avant d’agir. Cet outil, rarement utilisé, permet une action rapide et unilatérale pour rééquilibrer le commerce extérieur ou exercer une pression politique à court terme, comme cela avait été envisagé à la fin des années 1970 lors de tensions sur le dollar.
Qui plus est, la Section 301 du Trade Act of 1974, plus connue, vise à sanctionner les pratiques commerciales déloyales ou discriminatoires à l’égard des exportations américaines. Elle repose sur une enquête menée par le U.S. Trade Representative (USTR), qui détermine si un partenaire commercial fausse la concurrence ou viole ses engagements internationaux.
Si c’est le cas, l’administration peut imposer des tarifs, quotas ou restrictions ciblés, sans limitation de durée stricte. C’est cette base juridique que Donald Trump a utilisée en 2018 pour frapper la Chine, marquant le début de la guerre commerciale sino-américaine.
Enfin, la Section 338 du Tariff Act of 1930, héritée de l’ère protectionniste d’avant-guerre, autorise le président à imposer jusqu’à 50 % de droits de douane sur les pays qui discriminent le commerce américain, ou même à suspendre totalement les relations commerciales.
Bien que très puissante, cette disposition est rarement invoquée depuis la création du GATT et de l’OMC, car elle s’apparente à une mesure de rétorsion unilatérale contraire aux règles multilatérales du commerce. Elle reste néanmoins un instrument de menace crédible dans la panoplie présidentielle pour dissuader des politiques commerciales hostiles à Washington.
Ces dispositions législatives comportent toutefois des limites. Avant d'appliquer des mesures de rétorsion en vertu de l'article 301, par exemple, le représentant américain au commerce doit mener une enquête, consulter le pays concerné et publier les mesures envisagées ainsi que les éléments de fait sur lesquels elles se fondent. Si elles ne mettent pas fin à la guerre commerciale, ces contraintes pourraient au moins la ralentir.
Si la Cour suprême des États-Unis se prononce contre l'utilisation par Trump des pouvoirs d'urgence pour imposer des droits de douane généralisés en vertu de l'IEEPA, le gouvernement fédéral pourrait être tenu de rembourser entre 750 milliards et 1 000 milliards de dollars américains aux importateurs, y compris les entreprises et les gouvernements étrangers.
En résumé, les taxes de 2025 reposent sur une base juridique fragile. Elles ont déjà été jugées illégales par plusieurs juridictions fédérales, mais leur invalidation complète dépend désormais de la décision de la Cour suprême. Celle-ci pourrait, si elle confirme ces jugements, redéfinir durablement les limites du pouvoir présidentiel en matière de commerce international.
Les droits de douanes, un atout pour le déficit budgétaire
Depuis le printemps 2025, le marché obligataire américain vit une recomposition inédite. Les droits de douane imposés par Donald Trump, initialement perçus comme une menace pour la croissance et l’inflation mondiale, sont désormais considérés par les investisseurs comme un levier budgétaire central.
Cette transformation de perception est spectaculaire : d’un choc inflationniste et récessif en avril, les tarifs douaniers se sont mués en source potentielle de stabilisation des finances publiques.
En effet, le Congressional Budget Office (CBO) estime que les tarifs rapporteront 4 000 Mds $ sur la décennie, presque l’équivalent du coût du One Big Beautiful Bill Act (4 100 Mds $). Le Congressional Budget Office (CBO) estime que les hausses tarifaires actuelles réduiraient les déficits primaires d’environ 3 300 milliards de dollars et les paiements d’intérêts de 700 milliards supplémentaires d’ici 2035, soit un allègement budgétaire de près de 4 000 milliards sur dix ans.
À court terme, les chiffres impressionnent : plus de 200 Mds $ de recettes attendues en 2025, contre une moyenne de 80 Mds $ les cinq années précédentes. Le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, Bessent a suggéré une augmentation plus forte des recettes tarifaires, déclarant que pour l'année civile 2025, elles pourraient atteindre 300 milliards de $ d'ici la fin décembre.
Par exemple, en 2024, les droits de douane ont rapporté « seulement » 77 milliards de $ au Trésor. L'an dernier, sur les 4 900 milliards de $ perçus par le gouvernement fédéral, seuls 100 milliards provenaient des droits de douane.
Sur la base de ces résultats, les tarifs douaniers sont désormais devenus la quatrième source de revenus du gouvernement fédéral, derrière les recettes individuelles retenues à la source, soit 2 683 milliards de $ pour l’exercice, les recettes individuelles non retenues à la source, soit 965 milliards de $, et les impôts sur les sociétés, soit 392 milliards de $.
Ces rentrées fiscales contribuent à contenir la dynamique d’émissions du Trésor, tout en offrant un répit relatif aux notations souveraines : S&P et Fitch ont explicitement mentionné les recettes tarifaires dans leur décision de ne pas abaisser davantage la note américaine.
Toutefois, certes, les taxes douanières de Trump rapportent plus qu’avant, mais ne changent pas la donne budgétaire. Elles constituent une source ponctuelle de revenus, pas une solution structurelle.
En effet, le déficit budgétaire total américain pour l’exercice 2025 devrait atteindre environ 1 900 à 2 000 milliards de dollars, soit près de 7 % du PIB. Même dans le scénario haut (250-300 Mds $ de recettes tarifaires), ces taxes ne couvrent que 8 à 9 % du déficit annuel, et à peine 2 % des recettes fédérales totales (qui dépassent 4 000 Mds $).
En outre, les tarifs ne « marchent » que si la demande domestique reste forte et que les importations continuent de transiter par les canaux taxés. Dès que les flux se réorganisent (Chine → ASEAN, Europe), les recettes chutent.
Qui plus est, des droits de douane plus élevés réduisent la demande de biens étrangers, rétrécissant ainsi l'assiette fiscale. Ils réduisent également les recettes fiscales et salariales, annulant jusqu'à 25 % des gains, selon la plupart des estimations.
En effet, les droits de douane protègent certaines industries, mais augmentent le coût des intrants dans beaucoup d’autres, ce qui conduit généralement à des entreprises moins rentables et à des pertes d’emplois.
Cela se traduirait par moins de revenus, des masses salariales plus faibles et une baisse des bénéfices des entreprises soumis à l’impôt fédéral. Les recettes tarifaires augmenteraient, mais les sources de recettes les plus importantes pour le gouvernement diminueraient.
D’ailleurs, les estimations indépendantes des recettes douanières sont bien inférieures. Le modèle budgétaire de Penn Wharton estime que l'ensemble des tarifs proposés, rapporterait environ 290 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie. Ses calculs tiennent compte d'une demande d'importations plus faible, ainsi que de ses effets sur les recettes fiscales des sociétés et des salaires.
D'autres prévisions sont encore plus basses. Le Budget Lab de Yale, un centre de recherche non partisan, prévoit des recettes annuelles de 180 milliards de dollars ; la Tax Foundation, un groupe de réflexion, estime ce chiffre à environ 140 milliards de dollars.
De plus, l'administration pourrait modifier la gestion des politiques tarifaires. Les projections présentées ici reposent sur l'hypothèse que les droits de douane seront perçus sur toutes les importations concernées, sans exemptions autres que celles actuellement prévues. Si des mécanismes d'exemptions supplémentaires étaient mis en place, les droits de douane perçus pourraient diminuer considérablement.
Qui plus est, les États-Unis n'ont pas procédé à des augmentations de droits de douane de cette ampleur depuis plusieurs décennies. Par conséquent, il existe peu de données empiriques sur leurs effets à long terme.
Les consommateurs et les entreprises pourraient être plus ou moins réceptifs à des augmentations de droits de douane de cette ampleur, ce qui entraînerait un écart entre les recettes et les montants projetés.
L'ironie est que les droits de douane rendraient les dépenses américaines dépendantes de la production chinoise et de bien d’autres pays notamment d’Asie du Sud-Est.
Ainsi, l’effet positif sur le budget pourrait s’éroder avec le temps, sous l’effet du détournement des échanges et du coût inflationniste pour les consommateurs américains. Autrement dit, les tarifs douaniers offrent une respiration budgétaire, mais pas une stratégie de long terme.
Les conséquences sur les marchés financiers
Si la Cour suprême décidait d’annuler les droits de douane instaurés par Donald Trump, la réaction des marchés serait immédiate et contrastée. Dans un premier temps, les investisseurs interpréteraient cette décision comme une détente commerciale majeure.
Les indices actions réagiraient positivement, notamment le S&P 500 et le Nasdaq, tirés par les secteurs dépendants des importations comme la distribution, l’automobile et la technologie.
Sur le plan sectoriel, les effets seraient clairs. Certains segments de l’économie américaine y gagneraient nettement, tandis que d’autres verraient leurs marges comprimées et leurs valorisations se détériorer.
Les grands gagnants seraient avant tout les secteurs fortement dépendants des importations ou exposés à la mondialisation. Dans la consommation discrétionnaire, les distributeurs comme Walmart, Target ou Home Depot bénéficieraient immédiatement d’une baisse des coûts d’approvisionnement, ce qui soutiendrait leurs marges et pourrait se traduire par une détente sur les prix à la consommation.
L’électronique et la tech hardware (Apple, Dell, Nvidia, HP) verraient également un effet positif, puisque la majorité de leurs composants proviennent d’Asie. Ces entreprises gagneraient en compétitivité et en visibilité, surtout si le dollar s’affaiblissait dans le même temps.
Du côté industriel, les groupes manufacturiers ayant délocalisé leur production, General Electric, Caterpillar, Tesla pour la partie batteries, profiteraient d’un environnement de coûts plus prévisible et de chaînes d’approvisionnement moins perturbées. Enfin, les marchés émergents, notamment en Asie, bénéficieraient de la détente commerciale : les bourses de Shanghai, Séoul et Taipei verraient un afflux de capitaux, tiré par la réouverture partielle du commerce mondial.
Les perdants seraient les secteurs qui avaient tiré parti de la protection tarifaire. L’acier, l’aluminium et la pétrochimie, piliers du “Trump trade” industriel, subiraient une pression immédiate de la concurrence étrangère, notamment chinoise.
Les producteurs comme U.S. Steel ou Nucor verraient leurs prix domestiques reculer et leurs marges se comprimer. De même, l’agriculture protégée, qui bénéficiait de tarifs sur les importations concurrentes (blé, maïs, soja), perdrait son bouclier tarifaire, exposant les exploitants à une baisse des prix sur le marché intérieur.
Les valeurs énergétiques américaines (ExxonMobil, Chevron, Pioneer) pourraient aussi pâtir d’une baisse des anticipations d’inflation et d’une normalisation des flux commerciaux mondiaux, entraînant un repli des prix du pétrole et du gaz.
En somme, la décision de la Cour suprême créerait une fracture claire entre les secteurs orientés vers le commerce mondial, qui bénéficieraient d’un choc positif de marges et de valorisation, et les secteurs protectionnistes, qui perdraient leur rente tarifaire. L’indice S&P 500 dans son ensemble s’en trouverait dynamisé, mais au prix d’une rotation sectorielle brutale, un transfert de performance du “Trump trade” industriel vers le “global trade” mondialisé.
Le dollar se déprécierait légèrement, car la décision réduirait les anticipations d’inflation, diminuant ainsi la pression sur la Réserve fédérale. Dans le même mouvement, les obligations souveraines américaines profiteraient d’un rallye : les rendements à dix ans pourraient reculer de 10 à 20 points de base, traduisant une perception plus “dovish” du contexte monétaire.
Dans ce scénario, les anticipations d’inflation à court terme baisseraient, la Fed serait plus à l’aise pour assouplir sa politique, et la partie courte de la courbe se détendrait fortement, entraînant un bull steepening.
À court terme, cette décision serait donc perçue comme une normalisation bienvenue du commerce international et un signal de stabilité pour les marchés mondiaux.
Cependant, à moyen terme, la dynamique deviendrait plus incertaine. L’annulation fragiliserait la position budgétaire des États-Unis : les recettes douanières, estimées à environ 150 milliards de dollars sur l’année, disparaîtraient, creusant encore le déficit fédéral.
Ce manque à gagner pourrait peser sur la confiance des investisseurs obligataires, provoquant une remontée progressive des taux longs après l’effet d’euphorie initial. En parallèle, la perte de cet outil tarifaire affaiblirait le pouvoir exécutif, ouvrant une période de tensions politiques entre la Maison-Blanche et le Congrès.
Enfin, sur le plan géopolitique, le résultat serait clair : la Chine sortirait gagnante. Ces droits de douane constituaient l’un des rares leviers de pression commerciale encore efficaces. Leur disparition rendrait à nouveau les importations chinoises compétitives et fragiliserait la politique et la crédibilité de Trump.
En somme, l’annulation des droits de douane provoquerait d’abord un rallye “risk-on” sur les actions et les obligations, mais elle introduirait ensuite une incertitude budgétaire et politique durable. À court terme, les marchés salueraient la désescalade commerciale ; à plus long terme, ils devraient composer avec un déficit creusé et une gouvernance affaiblie.
En clair : Trump finance ses baisses d’impôts par une taxe sur la mondialisation. Mais pour le Trésor américain, c’est un pari risqué, et pour les marchés, un nouveau facteur de volatilité structurelle.





 Suivez les marchés avec des outils de pros !
Suivez les marchés avec des outils de pros !