La semaine dernière, les rendements des obligations d’État japonaises ont atteint des niveaux inimaginables il y a encore quelques années. Le rendement à dix ans a grimpé à 1,71 % et celui à vingt ans a atteint 2,822 %, un record depuis le début du siècle.

Un marché des obligations souveraines qui avait été le pilier mondial des rendements faibles, de la faible volatilité et de la désinflation structurelle pendant plus de trois décennies avait finalement commencé à évoluer.
Le Japon a longtemps joué un rôle discret de stabilisateur de la finance internationale. Grâce à sa politique de taux d’intérêt proches de zéro, au contrôle de sa courbe des taux, à une politique déflationniste et à un stock d’épargne colossal, le pays a exporté des capitaux à une échelle inégalée.
Les assureurs, les fonds de pension et les grandes banques japonaises achetaient des obligations étrangères non pas pour des raisons géopolitiques, mais parce que les rendements nationaux étaient insuffisants.
Ces sorties de capitaux persistantes ont soutenu les bons du Trésor américain, les obligations souveraines européennes et la dette des marchés émergents, et sont devenues un facteur structurel de maintien à la baisse des primes d’émission mondiales.
Cependant, dès que les rendements japonais ont commencé à remonter, la principale et la plus rigoureuse source de capitaux étrangers au monde a amorcé un repli sur elle-même. Ce changement marque la fin d’une époque.
Pendant la majeure partie de la période qui a suivi l’éclatement de la bulle dans les années 90, le Japon a été le principal exportateur mondial de déflation. Les rendements domestiques sont restés nuls ou proches de zéro pendant si longtemps qu’ils ont influencé à la fois le comportement des Japonais et les cours des actifs mondiaux.
Les institutions de Tokyo ont examiné leurs bilans, pris en compte leurs engagements à long terme et reconnu que le seul moyen d’obtenir des rendements acceptables était d’investir à l’étranger.
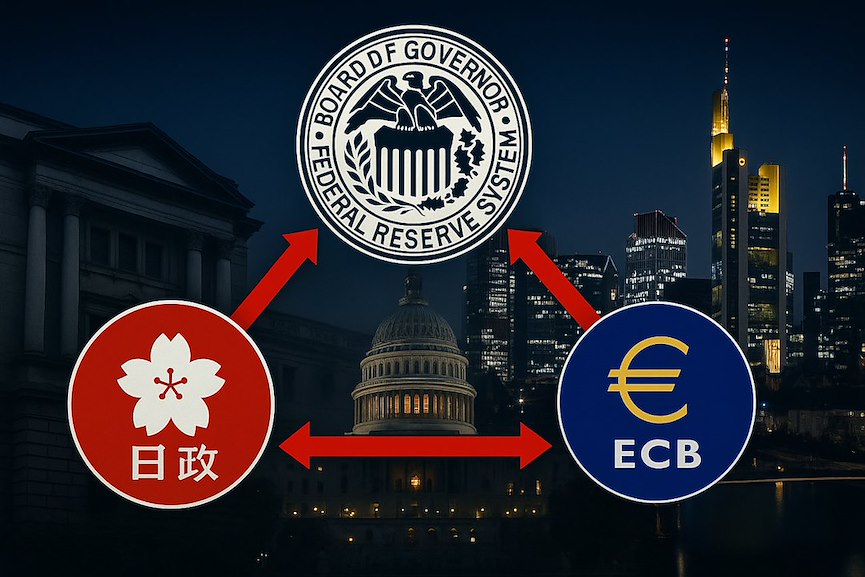
Elles ont acquis des bons du Trésor américain en masse. Elles ont absorbé des obligations souveraines européennes en période de crise. Elles ont financé des marchés émergents qui, autrement, auraient été confrontés à des conditions de financement beaucoup plus restrictives.
La fin d’un pilier mondial de liquidité
Cette surenchère constante s’est tellement ancrée dans le fonctionnement des marchés financiers mondiaux qu’elle en est devenue presque naturelle. Les États-Unis pouvaient ainsi creuser leurs déficits sans provoquer de fortes fluctuations des taux d’intérêt.
Les coûts d’emprunt européens sont restés stables, même lorsque la fragmentation politique menaçait la stabilité de l’union monétaire. Des stratégies d’investissement entières, comme la parité de risque, la macroéconomie basée sur le portage, les structures LDI et les cadres d’évaluation des actions technologiques à long terme, reposaient implicitement sur l’hypothèse que l’épargne japonaise comprimait le prix de l’argent.
Ce système est en train de s’effondrer. La hausse des rendements intérieurs crée une attraction irrésistible qui ramène les capitaux japonais au pays, et l’architecture financière mondiale qui dépendait des flux de capitaux sortants du Japon doit désormais s’adapter à un monde où ce soutien n’existe plus.
Le marché obligataire japonais ne s’est pas effondré à cause d’un événement isolé. Il s’est effondré suite à la convergence soudaine de tensions persistantes. Le gouvernement a annoncé un plan de relance d’environ 17 000 milliards de yens, une somme qui aurait dû soutenir la croissance, mais qui a au contraire incité les investisseurs à exiger une meilleure rémunération pour leurs obligations japonaises à long terme.
Parallèlement, la Banque du Japon avait déjà abandonné les taux négatifs, entamé une normalisation de sa politique monétaire pour la première fois depuis une génération et assoupli la courbe des taux à long terme.
Ces forces conjuguées ont créé ce que l’on peut qualifier de piège des taux d’intérêt. Les dépenses publiques ont fait grimper les taux, mais cette hausse a alourdi le coût du service de la dette colossale du Japon, qui représente aujourd’hui plus de deux fois et demie le PIB annuel du pays.
L’augmentation des coûts de service exige davantage d’émissions de dette, ce qui fait encore grimper les taux. Une fois ce cercle vicieux enclenché, il devient extrêmement difficile à maîtriser sans recourir à des interventions brutales qui nuiraient à la crédibilité de la banque centrale.
Le Japon est désormais confronté à une vérité dérangeante : il ne peut à la fois défendre le yen et contenir les taux d’intérêt à long terme. Les calculs budgétaires ne le permettent plus. Le marché obligataire l’a compris avant même que les décideurs politiques n’aient pu réagir, et les taux se sont ajustés en conséquence.
Pour la première fois depuis des décennies, les obligations japonaises offrent des rendements compétitifs par rapport aux bons du Trésor américain, une fois la couverture de change prise en compte.
Ce constat peut paraître technique, mais ses implications sont considérables. Les rendements des bons du Trésor américain couverts pour les investisseurs japonais sont déjà devenus négatifs sur plusieurs échéances, ce qui signifie que les institutions japonaises paient en réalité pour le privilège de détenir de la dette américaine lorsqu’elles se prémunissent contre le risque de change.
Dès lors que les rendements nationaux offrent une alternative plus sûre, plus transparente et moins coûteuse, l’incitation à conserver des capitaux à l’étranger disparaît.
Le piège des taux d’intérêt et le cercle vicieux de la dette
Le Japon détient plus de trois mille milliards de dollars d’actifs étrangers nets et environ mille milliards de dollars en bons du Trésor américain. Même un retour progressif de ces capitaux vers les marchés intérieurs aurait des conséquences profondes.
Les marchés obligataires des États-Unis, d’Europe et des économies émergentes dépendent depuis des décennies de la participation japonaise, et l’absence de cette participation entraîne une hausse des rendements.
La hausse des primes de terme mondiales que nous observons actuellement n’est pas principalement due aux anticipations d’inflation ou à la politique des banques centrales, mais plutôt au retrait de l’une des principales sources de demande structurelle au monde.
Ce mouvement de rapatriement des capitaux est discret, rationnel et implacable. Il ne nécessite ni panique ni crise pour remodeler les marchés mondiaux. Il suffit que les investisseurs japonais obtiennent des rendements acceptables dans leur pays d’origine, ce qu’ils peuvent enfin faire.
Le Japon se désengageant de son rôle de stabilisateur mondial, la responsabilité du maintien de la liquidité du système international se reporte inévitablement sur les États-Unis.
Or, le modèle américain est sans commune mesure avec le modèle japonais. Là où le Japon exportait ses excédents d’épargne, les États-Unis exportent des déficits d’une ampleur sans précédent dans l’histoire moderne.
La politique budgétaire américaine entre dans une nouvelle ère marquée par des engagements structurels en matière de dépenses. Les efforts de réindustrialisation, la construction d’une infrastructure nationale dédiée à l’intelligence artificielle, l’augmentation rapide du budget de la défense, la stabilité politique des programmes sociaux et la confrontation stratégique avec la Chine garantissent le maintien de déficits élevés dans un avenir prévisible.
Ces déficits nécessitent, par conséquent, d’importantes émissions de titres du Trésor.
En l’absence d’achats japonais, la Réserve fédérale devient la seule entité capable d’absorber cette offre sans provoquer de fluctuations désordonnées des taux d’intérêt. Cette dynamique marque le passage à une prédominance budgétaire, un régime où la politique monétaire est subordonnée aux besoins de financement de l’État.
Dans un tel système, les cycles de liquidité deviennent plus volatils et plus dépendants des décisions politiques. Le resserrement quantitatif ne peut se poursuivre indéfiniment, et l’idée que les banques centrales puissent réduire mécaniquement leur bilan année après année devient intenable.
À l’époque japonaise, la liquidité mondiale était ancrée dans l’épargne excédentaire. À l’époque américaine, elle sera déterminée par les déficits et les politiques visant à les monétiser. Ce cadre s’avérera plus instable et plus imprévisible.
Les conséquences de cette transition se font sentir dans toutes les grandes classes d’actifs.
Le long marché haussier des obligations mondiales est bel et bien terminé, et le risque de duration est redevenu une menace concrète, et non plus un concept théorique. Les valorisations boursières, qui reposaient sur des taux d’actualisation extrêmement bas, doivent s’adapter à un monde où les rendements à long terme sont structurellement plus élevés, même si les taux directeurs à court terme finissent par baisser.
Un rapatriement silencieux qui recompose la finance mondiale
Le carry trade en yen, qui a financé la prise de risque mondiale pendant deux décennies, entre désormais dans une période d’instabilité, la devise devenant plus volatile et les rendements nationaux augmentant.
De fait, pendant des années, le yen a été la monnaie de financement la plus économique et la plus stable au monde, permettant aux investisseurs d’emprunter à un coût quasi nul et de réinvestir ces capitaux dans des actifs plus rémunérateurs aux États-Unis, en Europe et sur les marchés émergents. Ce mécanisme constituait l’un des piliers structurels, souvent méconnus, de la liquidité mondiale, soutenant discrètement l’appétit pour le risque partout dans le monde.
L’or et le Bitcoin sont bien positionnés pour absorber les liquidités excédentaires lorsque les politiques budgétaires contraignent les banques centrales à assouplir leur politique monétaire malgré les craintes d’inflation.
Ces deux actifs tirent profit de leur rareté et de la corrélation croissante entre les injections de liquidités et les tensions sur les marchés. Parallèlement, les actions japonaises, notamment celles des secteurs bancaires et de l’assurance, pourraient enfin bénéficier d’un contexte favorable durable, la hausse des rendements accentuant la pente de la courbe des taux et l’élargissement des marges d’intérêt nettes.
La structure par terme des taux d’intérêt mondiaux se reconstruit en temps réel. Ce processus de reconstruction sera chaotique, inégal et parfois désordonné, mais sa direction est claire et irréversible.
L’issue la plus probable est un ajustement maîtrisé, dans lequel les taux japonais se stabilisent à des niveaux modérément élevés tandis que la Banque du Japon intervient de manière sélective pour atténuer la volatilité.
Dans ce scénario, les taux mondiaux atteignent un nouvel équilibre sensiblement supérieur aux niveaux observés au cours de la dernière décennie, sans toutefois atteindre un niveau susceptible de provoquer des tensions systémiques.
Il existe également un scénario optimiste plausible : les mesures de relance budgétaire et la croissance salariale au Japon pourraient enfin engendrer une période durable d’expansion nominale. Si le Japon parvient à se défaire de ses tendances déflationnistes, il pourrait connaître l’environnement économique le plus prometteur depuis plus de trente ans.
Ce serait une réussite pour le Japon, mais cela détournerait davantage de capitaux des marchés mondiaux et accentuerait la pression à la hausse sur les coûts d’emprunt internationaux.
Le scénario le plus risqué implique une réévaluation désordonnée des prix, avec une surévaluation des taux, des pertes de valorisation pour les institutions nationales et une accélération des ventes forcées d’actifs étrangers.
Ces fluctuations pourraient se propager aux marchés mondiaux et engendrer une instabilité sur les marchés actions, obligataires et des devises émergentes. Dans le scénario extrême le plus grave, des chocs simultanés aux États-Unis, en Chine et au Japon pourraient nécessiter une intervention coordonnée des principales banques centrales.
Les scénarios varient en intensité, mais le constat est unanime : le monde est entré dans un nouveau régime de taux d’intérêt qu’il est impossible d’inverser par de simples déclarations politiques ou des mesures d’assouplissement temporaires.
D’ailleurs, la réaction du yen est tout aussi révélatrice. La théorie macroéconomique classique suggérerait qu’une hausse des rendements japonais renforce le yen à mesure que les opérations de portage se dénouent.
Or, la devise s’est affaiblie au-delà de 156 yens pour un dollar. Il ne s’agit pas d’une contradiction, mais d’un changement dans la fonction de risque sous-jacente.
L’augmentation des émissions obligataires, la hausse des déficits et la possibilité d’une future monétisation font basculer le yen dans un régime de risque budgétaire plutôt que dans un régime de différentiel de taux.
Les marchés craignent désormais que le Japon ne doive à terme soutenir son échéance longue par une nouvelle expansion de son bilan, alors même que les opérations de portage deviennent structurellement instables.





 Suivez les marchés avec des outils de pros !
Suivez les marchés avec des outils de pros !